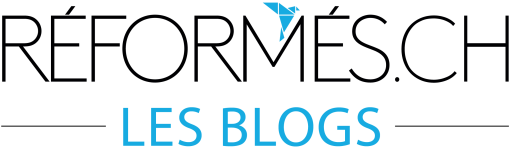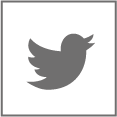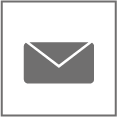Apprendre aux enfants que la mort fait partie de la vie
Faut-il parler de la mort aux enfants?

Isaline Vagnières
psychologue à la Fondation As’trame
ISALINE VAGNIÈRES Le fait de l’aborder par des livres ou à l’occasion d’événements de la vie, comme le fait de voir un animal mort, peut probablement aider lorsqu’un enfant est confronté au deuil d’un proche. Pas au niveau de la douleur ressentie, mais le fait d’amorcer des discussions permet de poser le fait que la mort est naturelle, qu’elle fait partie de la vie. Pour autant, cela ne doit pas être une injonction de le faire.
CÉCILE DOS SANTOS J’ai l’impression que cela se fait assez naturellement dans un cadre familial. Des enfants vont venir spontanément avec des questions à chaque âge de développement. La question est est-ce que l’on y répond ou pas? Mais les enfants nous laissent souvent peu le choix.
Pour protéger les enfants, certains parents préfèrent ne pas répondre.

Cécile dos Santos
psychiatre et psychothérapeute d’enfants et d’adolescents à Yverdon
IV Très souvent, les parents éludent la question pour de très bonnes raisons. Dans ma pratique, nous valorisons cette intention de protéger l’enfant. Les adultes n’osent pas évoquer la mort, car ils ont peur de mal le faire, de ne pas dire des choses justes et de blesser l’enfant. Mais les enfants sentent bien qu’il se passe quelque chose et le risque est qu’ils commencent à s’imaginer des choses qui sont parfois bien pires que la réalité
CDS Il m’arrive de rassurer des parents en leur disant que, finalement, les enfants vont toujours poser des questions pour lesquelles ils sont prêts à recevoir la réponse. Donc si l’on se fie aux questions des enfants, et qu’on y répond de manière honnête — pour l’enfant, mais aussi pour nous-mêmes — il y a peu de chances qu’on les heurte ou les dérange. Il y a beaucoup de chances que l’on arrive justement juste par rapport au stade de développement de l’enfant. Ce qu’il peut comprendre sera différent à 4 ans, 7 ans ou adolescent., mais aussi selon sa culture, sa foi ou sa religion éventuelle.
Les adultes peuvent aussi avoir des réticences personnelles?
CDS C’est sûr qu’il y a des émotions inconfortables qui sont associées à la mort. Avec nos enfants, nous préférons généralement parler foot. En plus, on ne sait pas toujours répondre à ces questions-là. Notre société valorise les réponses claires et nettes. En conséquence, les parents n’aiment pas trop dire qu’ils ne savent pas et qu’ils doivent chercher.
IV Les adultes peuvent aussi avoir peur d’être renvoyés à leurs propres émotions. Ils peuvent avoir peur de ne pas savoir les gérer. C’est pour cela que nous respectons l’intention de protéger les enfants.
Le risque n’est-il pas de faire de la mort un tabou?
CDS Si l’on n’est pas prêt à aborder ces thèmes-là en tant qu’adulte, je pense que c’est chouette de pouvoir se faire accompagner. C’est peut-être même l’un des buts de nos métiers. Par contre, la mort est une question que j’aborde quasiment systématiquement avec mes nouveaux patients. Cela me permet d’en apprendre beaucoup sur leur système de valeurs et c’est aussi une façon de faire passer le message, qu’avec moi, ils ont le droit d’en parler.
IV Effectivement, il faut reconnaître que ce n’est pas facile de parler de la mort, mais, en même temps, dire que l’enfant a besoin que l’on mette des mots sur ce qui se passe. Les enfants vivent mieux les moments de deuil quand il y a des mots qui sont posés sur ce qui est vécu, quand on peut parler de la personne décédée.
Faut-il faire participer les enfants aux visites de malades ou aux rites liés à la mort?
CDS De nouveau, il n’y a pas une réponse univoque. Cela va dépendre beaucoup d’à quoi l’enfant a été habitué, quelle est la pratique de la famille et si cela sera confortable pour elle. Mais, a priori, dans les principes par rapport au développement de l’enfant et à sa cognition, plus on lui montre les choses, qu’éventuellement on lui présente le corps, plus on l’accompagne et qu’il fait partie de tout le processus que traverse la famille, plus il sera rassuré. Mais, une fois encore, cela dépend vraiment des familles
IV Effectivement, c’est important que la personne qui accompagne l’enfant se sente de le faire. Ce qui pourrait être compliqué pour l’enfant, c’est de se retrouver seul avec une personne qui n’est plus en capacité de prendre soin de lui. Après, le fait d’exprimer ses émotions est positif. Il est précieux de montrer à l’enfant que les adultes ont des émotions et qu’elles peuvent être exprimées.
CDS Dans tous les cas, ce ne sont pas des questions faciles. Le fait d’amorcer des discussions sur ces sujets et d’expliquer le sens des rites avant d’être confronté au deuil est aidant. D’autant plus que ces rites n’ont pas été inventés pour rien et qu’ils font énormément de bien à l’ensemble de la famille. C’est vraiment un moment essentiel du processus de deuil. Mais, de nouveau, si la famille n’a pas l’habitude de le faire et le fait autrement, ce n’est pas grave
Dans ma pratique, par exemple, je constate régulièrement que pour des familles migrantes, le fait de ne pas pouvoir participer aux rites qui ont lieu dans un autre pays peut être vraiment difficile.
IV Les rites, on peut aussi les inventer. Aujourd’hui, les familles inventent de nouveaux rites. À As’trame, on organise des journées pour les familles en deuil lors desquelles on propose un geste, comme allumer une bougie en pensant à la personne décédée. Ce qui est important, c’est de faire quelque chose dont le sens est compris par les familles.
Comment les enfants gèrent-ils le fait d’être confrontés à des réponses qui peuvent être divergentes sur la mort?
CDS Je pense qu’il faut accompagner l’enfant et l’écouter, entendre ce qu’il a à en dire, comment résonne pour lui ce qu’on a pu lui dire sur la mort par rapport à ce qu’il savait, et puis essayer de co-construire une réponse avec lui, à partir de sa représentation, mais aussi de son vécu
Je parle de vécu, car il y a quand même beaucoup d’enfants qui racontent autour du deuil, vivre des expériences peut-être non ordinaires, où ils revoient des traces de la personne disparue. Très souvent, les morts reviennent dans les rêves, parfois c’est un ressenti. Les enfants disent sentir la présence d’un proche disparu. Les limites avec l’imaginaire paraissent moins franches chez les enfants que chez les adultes et ils laissent ainsi plus de place au continuum de la relation. Ainsi, une question qui interpelle beaucoup les enfants, d’où qu’ils viennent, est celle des Enfers. Quand un camarade leur dit qu’ils vont y aller ou qu’un proche va s’y retrouver, l’enfant a généralement déjà une certaine réponse. S’il trouve que ce n’est pas juste ou que cela fait peur, il va rejeter cette hypothèse.
IV Il est important de partir de l’enfant, de l’amener à exprimer ce que lui ressent, ce qu’il pense ou simplement de parler de ce qu’il a entendu. Ce que nous faisons à As’trame, c’est de parler des différentes croyances qui existent.
CDS De manière générale, je pense que si l’on fait une réponse univoque à un enfant et que cela ne correspond pas à son expérience, il ira reposer la question un peu plus loin…
Ressources
La Fondation As’trame est présente partout en Suisse romande. Elle vient en aide aux enfants, jeunes et familles bouleversées par les événements de la vie (www.astrame.ch).
Pour parler de la mort avec les plus jeunes, Cécile dos Santos et Isaline Vagnières conseillent les livres suivants:
- Mon chagrin éléphant, Cécile Roumiguière et Madalena Matoso, édition Thierry Magnier, 2015;
- Tu vivras dans nos cœurs pour toujours…, Britta Teckentrup et Rose-Marie Vassalo, Larousse, 2018;
- Au revoir Blaireau, Susan Varley, Gallimard, première édition 1984;
- Bonjour Madame la mort, Pascal Teulade et Jean-Charles Sarrazin, L’école des loisirs, première édition 1997.