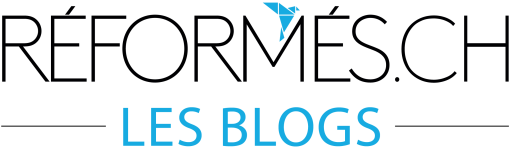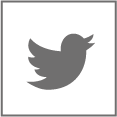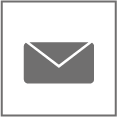Un chemin de métamorphose
Deborah Frauche,envoyée de DM.
Un Dieu moins «borné»
Elle a participé l’été dernier au séminaire d’islamologie dispensé par l’Institut oecuménique de théologie Al Mowafaqa, à Rabat, au Maroc.«C’était une occasion inespérée de découvrir l’islam de l’intérieur», explique la septuagénaire établie en Valais. Les professeurs, parmi lesquels plusieurs femmes, étaient en majorité musulmans. La rencontre lui a ouvert les yeux sur la variété des approches présentes dans l’islam. Elle a pu constater qu’il y avait autant de libéralisme dans cette religion que dans le protestantisme. Depuis cette expérience, la foi de Deborah Frauche est devenue plus universelle: elle voit Dieu plus grand et moins «borné» que ce qu’elle imaginait. «Je prie aussi différemment, englobant dans ma prière davantage le monde et tous ceux qui souffrent, qu’ils soient palestiniens ou israéliens.» À la suite de ce séjour au Maroc, un souhait profond est né en elle: celui d'une ouverture plus grande de l'Église protestante envers les musulmans ainsi que de construire des liens entre les religions en se concentrant sur les aspirations humaines universellement partagées: que ce soit le désir de paix ou l'aspiration au bonheur. Elle projette d’ailleurs de participer à un groupe interreligieux.
Raoul Pagnamenta, pasteur à Saint-Blaise-Hauterive-Marin (NE).
«Chaque rencontre apporte des changements, même inconscients»
L’année dernière, je suis parti au Japon durant les quatre mois de mon temps sabbatique pour suivre une ‹ initiation au dialogue interreligieux, à la foi chrétienne et aux autres religions pratiquées dans le pays ›. Pour moi, chaque rencontre dans le cadre interreligieux apporte des changements, même si l’on n’en est pas forcément conscient. Nous avons visité des lieux phares du shintoïsme, du bouddhisme et de ‹ nouvelles religions ›. En discutant avec des prêtres et des moines, j’ai été surpris de découvrir que le bouddhisme de la Terre pure ressemble beaucoup à la foi chrétienne. Cette similarité inattendue – un engagement social fort et un service d’aumônerie notamment – m’a interpellé et donné envie de poursuivre un dialogue avec cette tradition.
Etre immergé dans un pays où le christianisme est marginal m’a poussé à m’ancrer dans ma propre foi et dans le désir de mieux la connaître. J’ai eu besoin d’aller au culte tous les dimanches. Je me suis réjoui de certaines pratiques traditionnelles – la leur date de la fin du XIXe siècle –, qui m’ont fait me sentir à la maison. Etre en contact avec d’autres religions me donne plus conscience des idées de la mienne.»

Violaine Némitz,retraitée, Bienne (BE).
«J’ai appris très tôt que les religions pouvaient vivre côte à côte»
En 1949, à l’âge de 7 ans, Violaine Némitz quitte le Jura bernois pour Alexandrie, où son père est appelé comme pasteur. Elle découvre une Egypte en pleine effervescence: le pays sort meurtri de la guerre israélo-arabe de 1948, le roi Farouk est discrédité, les nationalistes montent en puissance et l’islam politique est réprimé après l’assassinat du fondateur des Frères musulmans. Dans cette ville cosmopolite où cohabitent orthodoxes, juifs, catholiques,protestants et musulmans, l’État oblige les étrangers aisés à employer du personnel local, ce qui amène Violaine à côtoyer chaque jour des Egyptiens musulmans et à apprendre l’arabe. Le choc culturel est profond: climat, langue, société coloniale. Mais c’est surtout la rencontre avec d’autres traditions religieuses qui transforme sa foi. «J’ai appris très tôt que les religions pouvaient vivre côte à côte.» Elle se souvient aussi des tensions grandissantes envers les personnes juives après la création de l’État d’Israël en 1948, qui la poussent à réfléchir: comment aimer Dieu dans un monde marqué par le rejet? Ce séjour de neuf ans a élargi son horizon spirituel. «En Suisse, à mon retour, on critiquait encore facilement les catholiques. Je ne pouvais plus entrer dans cette logique.» Elle voit dans cette période un tournant: «Sans l’Egypte, ma foi serait restée enfermée.»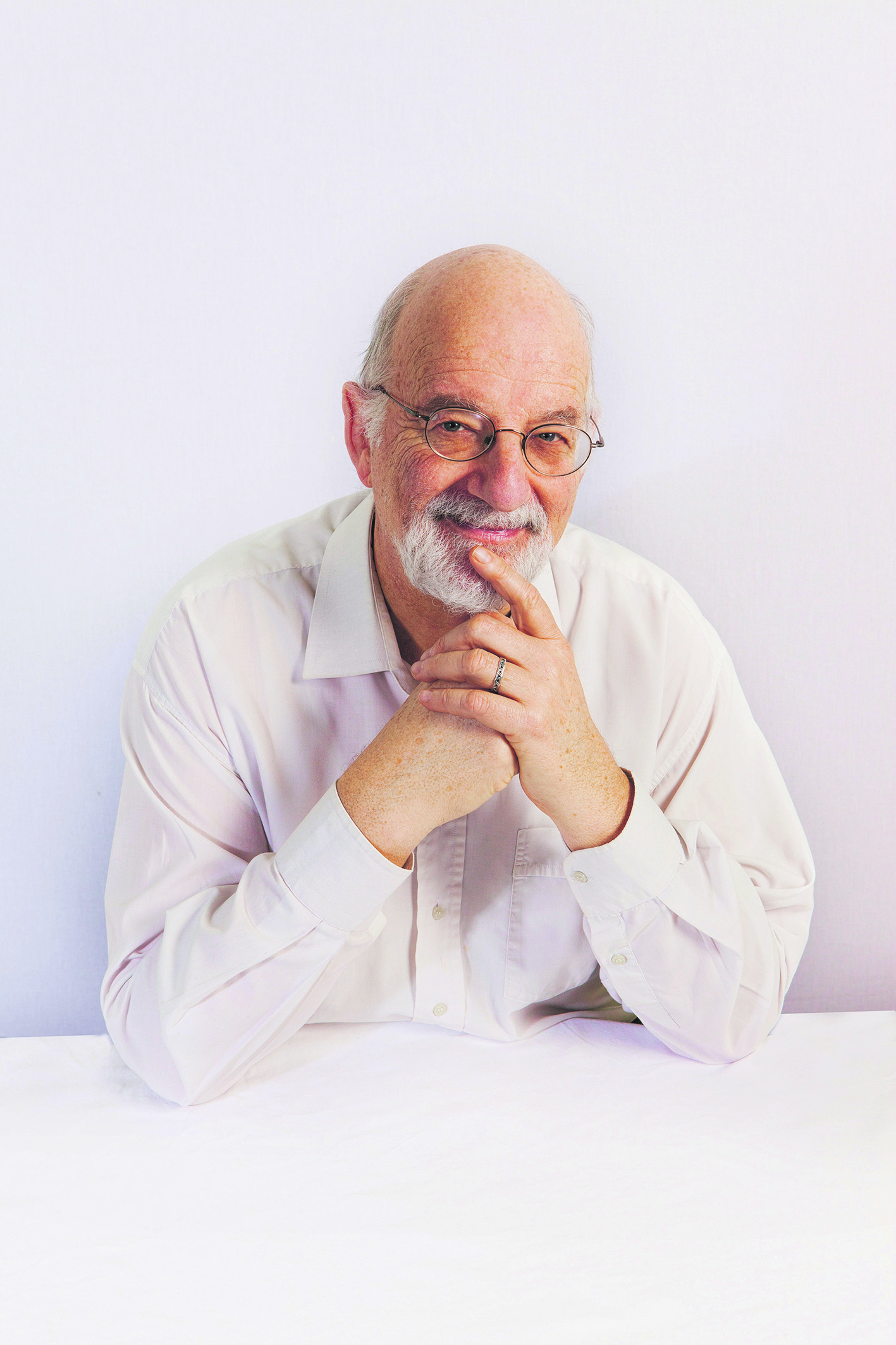
Maurice Gardiol,membre du comité exécutif de la Plateforme interreligieuse de Genève.
«Comment repenser ma manière de concevoir la vérité?»
C’est durant mon ministère auprès des requérants d’asile et des réfugiés que j’ai été confronté pour la première fois à l’interreligieux. En partageant avec des personnes d’autres cultures, religions et traditions, j’ai compris la nécessité de découvrir et d’écouter l’autre, et mon chemin spirituel a commencé. Mes expériences interreligieuses m’ont fait questionner et approfondir ma propre religion, ont fait évoluer et grandir ma foi et ma spiritualité pour les interroger, voir comment un dialogue avec les autres est possible, comment s’ouvrir à ces spiritualités différentes. Nos propres convictions sont nécessairement interpellées, on ne peut pas se contenter de certaines réponses et d’énoncés que l’on avait. L’interreligieux est une source d’enrichissement réciproque qui permet de vivre de manière plus dense, plus intense, plus en dialogue. Une des grandes questions que pose ce dialogue est celle de la vérité. Comment repenser ma manière de la concevoir? Il faut essayer de relire avec une optique plus ouverte ce que l’on a entendu de manière exclusive, se dire que l’on ne détient pas la vérité. Il y a des façons différentes d’entendre la parole du Christ.»
Janique Perrin, responsable de la formation des Églises réformées Berne-Jura-Soleure.
Le bouddhisme tibétain comme influence
Grande voyageuse, Janique Perrin a été profondément touchée par le bouddhisme tibétain. Dans sa jeunesse, elle a même envisagé de se consacrer à cette religion orientale. De son séjour à Dharamsala, refuge et capitale de l’exil tibétain au nord de l’Inde, elle a gardé dans sa pratique une sensibilité issue du bouddhisme. En témoignent son goût pour la méditation, les retraites et, surtout, sa conviction que les religions doivent rester en dialogue. «J’ai commencé mes études de théologie en m’approchant du boud-dhismetibétain», considère-t-elle. Une période qui a laissé une empreinte dans sa manière de voir la spiritualité. Son mémoire de licence portera sur la comparaison de la compassion dans le Dhammapada –fleuron des écrits canoniques du bouddhisme– et l’Epître de Jacques. Le bouddhisme l’a aussi ouverte à une autre vision des relations humaines, à travers les esprits et les âmes. Une dimension au-delà du rationnel, souvent écartée, selon elle, par le christianisme occidental. Aujourd’hui, JaniquePerrin se sent complètement chrétienne et réformée. Le bouddhisme, pour lequel elle conserve une grande estime et de l’affection, lui a permis d’ouvrir des portes spirituelles et d’enrichir sa propre foi.
Antoine Nouis,théologien, auteur d’une vingtaine de livres sur la Bible et la spiritualité.
«J’ai découvert une nouvelle façon de lire la Bible»
S’il s’est passionné pour la méthode historico-critique enseignée en Faculté de théologie, celui qui fut pasteur durant près de 30 ans n’a pas trouvé de ressource pour «celui qui doit prêcher tous les dimanches» dans cette analyse des textes bibliques prenant en compte le contexte historique de leur sauteurs et destinataires.
Il vit un premier déplacement alors qu’il est accueilli un an par une église mennonite aux États-Unis. «J’ai pris conscience que j’avais découvert l’Evangile à travers une culture qui était la culture française et à travers une tradition exégétique qui était la tradition réformée. Et que ce rapport à l’Evangile qui me semblait naturel était l’objet d’une construction.» De retour en France, il fait la connaissance du rabbin de Valence qui lui propose d’intégrer un groupe de lecture des commentaires de Rachi de Troyes (du XIesiècle). Antoine Nouis découvre avec lui la richesse de l’herméneutique rabbinique qu’il applique aujourd’hui également aux textes du Nouveau Testament. Elle est orientée vers l’actualisation et pose le principe de la lecture infinie: «Aucune interprétation ne saurait épuiser le sens du texte. C’est la multiplication des interprétations différentes qui permet d’approcher le sens.»